La Grave – La Girose, du
rocher au glacier
Citer
cet article
La Grave – La
Girose, du rocher au glacier
Paul Billon-Grand –
Version 3.0, 8 juillet 2025
|

Figure 1 – Glacier de la Girose, depuis le Plateau d’Emparis. |
« De quoi
la Girose est-elle le nom ? ».
C’est le
titre d’un article très intéressant et bien documenté du géographe Félix
de Montety (1) qui s’interroge sur le nom du
glacier homonyme objet d’un projet d’équipement controversé.
On se
focalise en effet aujourd’hui sur le glacier, mais, d’un point de vue
historique, « la Girose » n’est pas connue en tant que glacier !
C’est en
réalité une portion du versant de la montagne au-dessous du glacier qui
s’appelle « Girose » depuis des ‘temps immémoriaux’, comme on dit ! |
On le connaît grâce
à la présence de cristallières et de filons de plomb sporadiquement exploités
autrefois. Tout se passe comme si, avec le développement du tourisme, on
découvrait ou inventait à nouveau les lieux, en oubliant que « la Girose » est
fréquentée depuis au moins le Moyen Âge, par les habitants (chasseurs, pasteurs,
cueilleurs), par les géomètres, géodésiens et autres topographes, mais aussi par
les prospecteurs et exploitants des cristallières et des mines. Les touristes,
futurs alpinistes, ne sont apparus de façon notable que durant les années 1870,
alors que les habitants s’aventuraient déjà sur les glaciers à la chasse des
chamois ou pour aller et venir entre La Grave et Mont-de-Lans d’un côté et
Saint-Christophe de l’autre par le col de la Lauze (2).
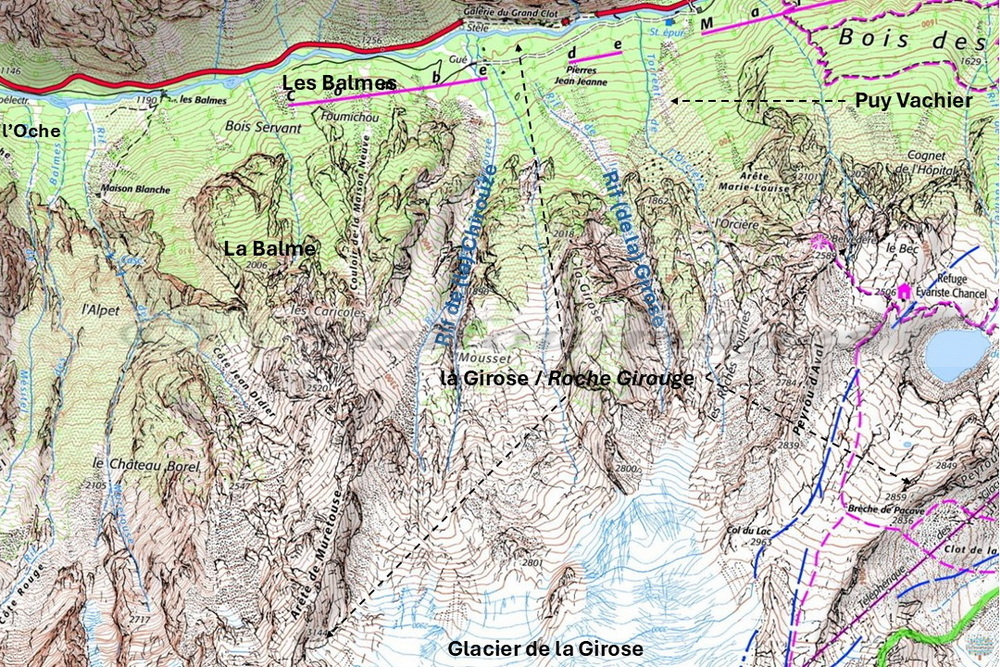
Figure 2 – La Girose, plan de situation. Report des données du cadastre (plans
de section et feuille de la section K). ADHA
Le nom d’un quartier
Le cadastre de la
commune de La Grave, réalisé en 1811, comporte un quartier nommé « Girose »
(3) qui se trouve sur la rive gauche de la Romanche entre
le torrent des Abéous et le Rif de (la) Chirouze d’une part, et s’élève de la
Romanche, en face du Grand Clot (4), jusque vers 2600 m
d’autre part. À l’amont, le quartier de Puy Vachier le sépare de la Romanche
(Fig. 2). Le lieu-dit a été visé et donc géolocalisé depuis le signal des
‘3 petits lacs’ (ils n’existent plus en tant que tels, mais le signal se
trouvait au nord immédiat du Lac Noir sur le Plateau d’Emparis et depuis le
‘signal de Romerta’ (le nom est tombé en désuétude, mais le signal se
trouvait à proximité de Serre Bernard) lors de la triangulation du territoire de
La Grave par les géomètres de 1re classe, MM. Kirwan et Durand, en
1811 (Fig. 3, 4).
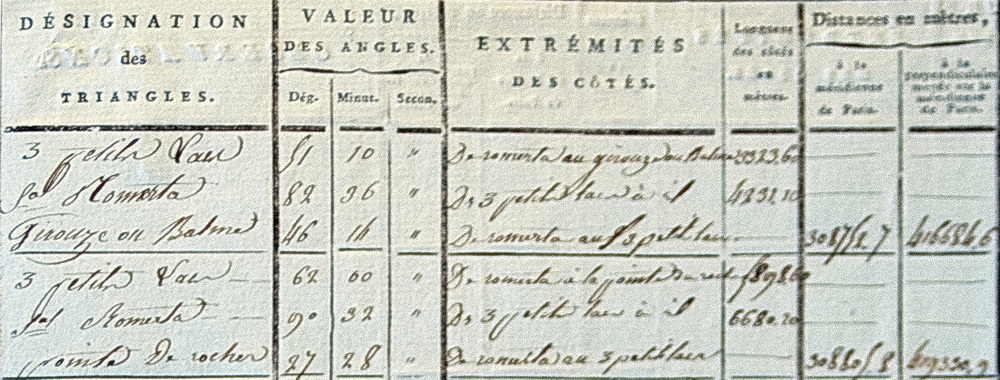
Canevas de triangulation du cadastre de La Grave :
Figure 3 (ci-dessus) – Définition de deux triangles.
Figure 4 (ci-contre) – Girouse tel qu’écrit sur le canevas.
La réponse à la
question de départ apparaît donc simple : « la Girose » est le nom du quartier
rocheux situé dans la pente juste au-dessous du glacier, tel que défini par le
cadastre et confirmé par la carte IGN au 1/25 000 (Fig. 2). Au sens strict,
le secteur nommé « Girose » ne couvre donc pas la zone glaciaire.
Mais comme il est
courant en montagne, par éponymie, le nom s’est transmis au torrent qui le
traverse, puis au glacier qui le domine et est même monté jusqu’à la crête avec
le « Col de la Girose », qui lui-même se cache dans la crête du Col sur
le tableau d’assemblage du cadastre de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans
(1929) et dans le Glacier du Col de l’autre côté, pour le « Glacier de la
Selle ».
De prime abord, ce
nom « Girose », prononcé [d͡ʒiruzə] (‘djirouze’, ‘r’ roulé), paraît
effectivement obscur. On ne peut pas le rattacher à un paronyme en français ou
en patois local (5) qui aurait pu le remotiver. Mais on
peut bien sûr le rapprocher de « Chirouze », prononcé [t͡ʃiruzə] ('tchirouze',
'r' roulé) qui nomme un
autre torrent émissaire du bassin glaciaire de la Girose, au sens bien établi
dans la région de ‘lieu rocheux’ ou de ‘gros rocher’. L’un et l’autre nom, « Girose,
Chirouze », sont deux variantes phonétiques, et peut-être diachroniques, issues
d’un même étymon rattaché à la racine *kar, *gar, *gir =
‘rocher, hauteur" (6), avec le suffixe -osa courant
dans la région. Ils nomment les masses rocheuses qui dominent la rive gauche
de la Romanche à la hauteur du Grand Clot.
« Girose » est
apparenté aux ‘torrents rocheux’ ou ‘torrents des rochers’ des vallées
voisines : « Gyronde, Gironde, Gérendoine » en Vallouise (7),
« Rio Geronda » dans la haute vallée de Suse (It.).
« Chirouze » est
encore compris et présent localement (en Briançonnais une _chirouze_
désigne une ‘grosse pierre dans le lit d’un torrent’
(Figure 5 ci-dessus, Pont de la Chirouze, Saint-Martin-de-Queyrières, photo P.
B-G).
Il peut correspondre
à une évolution minime dans le temps ou/et dans l’espace de la prononciation de
« Girose » au niveau de la première syllabe, [‘d͡ʒi-] > [t͡ʃi-] (‘dji-’ > ‘tchi-‘),
la seconde restant inchangée (‘o’ se prononçant [u] (‘ou’). Toutefois, on peut
aussi considérer que les différences entre les deux graphies restent dans la
limite de la variabilité des transcriptions phonétiques (8).
Dans les deux cas, on se trouve face à deux variantes d’un même toponyme
pour nommer le grand versant rocheux sous le glacier (9).
L’évolution du nom
Girose
Il est difficile de
suivre l’évolution du nom dans le temps dans la mesure où, contrairement à « Gyronde »
(en Vallouise), on ne dispose pas de formes anciennes, du moins en l’état de la
connaissance. Ni les cartes anciennes (XVIIe, 1re moitié XVIIIe
s.) à petites échelles, ni les cartes à plus grande échelle (1/86 400) de la
seconde moitié du XVIIIe siècle (Cassini et Bourcet) ne mentionnent
« la Girose ». Même les minutes au 1/14 400 de Bourcet de la Saigne ne
l’indiquent pas, mais elles permettent toutefois de bien suivre la route dans la
vallée de la Romanche avec les noms des différents ponts et donnent une bonne
idée du versant de la Girose. Elles introduisent même une (encore énigmatique)
Pointe Haute du Grand Glacier (hors champ).
Tiens, tiens, y
aurait-il un grand glacier dans le secteur (infra) ? (Fig. 6).
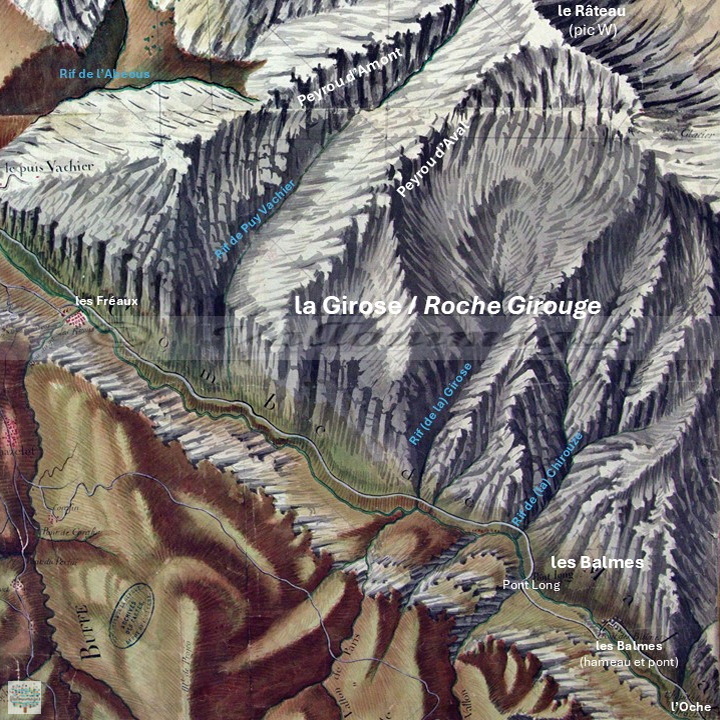
Figure 6 – Extrait des Minutes de la carte de Bourcet de la Saigne, v.
1750. SHD.
Les plus anciennes
mentions remontent à la fin du XVIIIe siècle avec l’arrivée des
premiers voyageurs naturalistes, souvent à la recherche de minerais, minéraux et
autres crystaux.
Ainsi, Jean-Étienne
Guettard (10), à la suite de son second voyage en Dauphiné
en 1775, désigne « le (les) glacier(s) de Girose »
(11),
« le glacier de la montagne de Girose »
(12)
et « la montagne de la Girose »
(13).
On notera l’hésitation sur l’utilisation de l’article défini (Annexe 2 - § 4).
De même, Antoine d’Hellancourt,
lors de son voyage en Oisans en 1785, mentionne « la montagne d’Échilose »
(14)
et décrit « la mine d’Échilose […] précisément sous un glacier […] »
(15),
dont Paul Guillemin rectifie le nom en note : « le vrai nom est Girose : il est
resté appliqué à la mine de plomb et au beau glacier qui plonge vers la
Romanche. » Toutefois, Paul Guillemin saute une étape car l’analyse (16)
rattache « Échilose » à « Chirouze » en roulant le ‘r’, qui lui-même est une
variante de « Girose ».
Les deux sont
d’accord sur la montagne et la mine « de Girose » pour Guettard et « de Chirouze »
pour d’Hellancourt. Les deux variantes avaient donc cours simultanément pour
désigner la « montagne de Girose », située au-dessous le glacier.
Louis-Étienne
Héricart de Thury, ingénieur des mines, à la suite de ses voyages de 1805 à
1807, évoque « … les riches filons de plomb de Giroze, de l’Ourcière et de
Pariset, situés au milieu des glaciers de la commune de la Grave … » et parle
des « granits de Girauze » et des « cristallières de Girauze »
(17),
dans une graphie, certes homophone en français mais plus du tout en patois
local, reprise plus tard par Bernard Amouretti (18).
Le Journal
d'agriculture et des arts pour le département des Hautes-Alpes publie en mai
1809 un rapport sur les mines de l’arrondissement de Briançon, qui mentionne les
filons de l’Ourcière, et « au lieu-dit Girose, près des glaciers […] »
(19).
Le cadastre de la
commune de La Grave réalisé en 1811 introduit deux graphies, Girouse dans
le canevas trigonométrique et Roche Girouge dans les états de sections.
Les deux opérations n’ayant pas été réalisées par les mêmes personnes, on est
confronté à la difficulté de la variabilité phonétique déjà évoquée (20).
Sachant que le ‘o’ se prononçait [u] (‘ou’), Girouse correspond à « Girose »,
tandis que l’informateur pour les états de sections devait prononcer [d͡ʒirudzə]
(‘djiroudze’), très proche de [d͡ʒirudʒə] (‘djiroudje’). Le pléonasme Roche
Girouge, lui, indique que la signification du nom étant perdue, il a fallu
le remotiver par un synonyme. La toponymie est remplie de ce genre de doublon (21) !
En 1908, Jules
Ronjat, linguiste occitan, reprend Roche Girouge et en fait « la vraie
forme indigène » francisée qu’il reconstitue en Rocha Giroujo (22),
à prononcer [d͡ʒirudʒə] (‘djiroudje’) ou [d͡ʒirudzə] (‘djiroudze’), soit [d͡ʒiruzə]
(‘djirouze’, ‘r’ roulé), soit Girose.
Il a en outre émis
l’hypothèse que Roche Girouge correspondrait à ‘roche gelée ou gelive’
d’un latin *gelotica (23). Dans une communication à
la Société d’Études Provençales en 1907, il avait été plus précis : « Rocha
Giroujo (lat. gelotica croisé avec gelosa dans la graphie
administrative Girose. »
(24).
Il s’agissait d’un curieux croisement entre deux termes qui correspondent à deux
idées opposées : ‘roche gelée’ celle d’un durcissement ou de la cristallisation
par le froid, ‘roche gélive’ celle d’une fracturation de la roche par le froid.
En ne retenant que *gelotica, il privilégie la gélivation qui ne fait pas
particulièrement partie des propriétés des granits et des gneiss.
De Guettard à Ronjat,
en passant par le cadastre, on reste dans la limite de la variabilité des
transcriptions phonétiques : girouse, giroze, girouge,
giroujo
(25)
ne sont que des versions phonétiques de girose.
On réalise que
jusqu’aux premières décennies XXe siècle, « la Girose » n’est connue
que pour ses mines et cristallières. Du grand glacier, il n’est pas question
sauf pour indiquer la dangerosité de leurs exploitations intermittentes et de
peu de rapport.
Le glacier au Moyen
Âge
Pourtant il était
bien là, mais on ne s’y intéressait pas beaucoup. La pauvreté de la toponymie
d’altitude concernant les sommets, les cols et les glaciers est bien connue (26,
27), mais on trouve néanmoins des références aux glaciers
dans des documents remontant au Moyen Âge. La plus ancienne mention date de 1318
dans un document de bornage à Mont-de-Lans, parrochia de Lento dans le
document, où l’expression usque ad nives varias, ‘jusqu’aux neiges
changeantes’ correspond au bornage d’une ‘montagne’ (pâturage) à la limite des
névés, c’est-à-dire ici à la limite ouest du Glacier de Mont-de-Lans. Dans le
même texte, un bornage est fixé ad usque Mantellum, sommet de Roche
Mantel, donc à la limite du Glacier de Mantel au XIVe siècle. Cela
fait dire à André Allix que « nous avons là une forte présomption que le Glacier
de Mont-de-Lans ou de Mantel au XIVe siècle oscillait dans des
limites voisines de celles qu’il a connu au XIXe »
(28).
Deux autres documents du XVe siècle, également relatifs à des
bornages dans le vallon de Lanchâtra, mentionnent l’un, une montagne qui se
termine au glacier, et l’autre, un glacier qui pousse sa langue jusque dans
l’herbe, ce qui laisse présager une poussée glaciaire (29).
Les cartes anciennes
Les cartes anciennes
ne mentionnent pas directement les glaciers, qui ne sont pas représentés, mais
ils apparaissent dans les Montagnes ou Les Neges ne Fondes jamais, nom
qui figure sur plusieurs cartes de la fin du XVIIe siècle ou du début
du XVIIIe, comme chez La Blottière. Jusqu’au milieu du XVIIIe
siècle, les noms concernent des massifs entiers, ainsi tout l’ensemble
montagneux, entre Mont-de-Lans et le Lautaret, aujourd’hui massif de la Meije,
avec ses glaciers et ses sommets, était regroupé sous des appellations générales
comme « Montagne de Malavalle, vis-à-vis les vilages de la Grave et de
Villars d’Arayne sur lesquelles il y a beaucoup de glaciers »
(30).
Le général de Bourcet parle aussi « des glaciers de la Montagne de Malavallée »
(31).
Dans ce cas, la montagne est désignée en référence à la vallée de la Romanche.

Figure 7 – Extrait des Minutes de la carte de Bourcet de la Saigne,
secteur du Grand Glacier, v. 1750. SHD.
Les minutes de la
carte de Bourcet de la Saigne (Figures 6 du côté de la Girose et 7 du côté des
sommets) au milieu du XVIIIe siècle ne représentent pas les glaciers,
mais font ressortir un nom de sommet intéressant, la
« Pointe Haute du Grand
Glacier ». Qu’il s’agisse du Pic Ouest du Râteau ou du Pic de La Grave, la
désignation « Grand Glacier » est suffisamment explicite. Deux autres sommets de
la crête sont désignés par les « deux pointes du Haut Glacier ». Aucun doute,
nous y sommes ! Toutefois, les discordances sont trop nombreuses entre les
minutes et le canevas de triangulation pour être sûr des équivalences avec les
noms sur les minutes et des localisations.
Le Mont (de) Lens
Dans les dernières
décennies du XVIIe siècle, un autre nom apparaît sur les cartes pour
désigner le massif de la Meije : Mont de Lens, avec une variante Mont de
Liens sur une carte de Nicolas Sanson de 1710. L’ancienne petite route de
Grenoble à Briançon traversait la parrochia de Lento (supra), soit
la ‘paroisse de lent’ : elle rejoignait le village de Lent, puis
Lens, et enfin Lan, Lans, par une montée raide et scabreuse
depuis le Châtelard, – qui lui valut les désignations puis les noms de Mont
de Lens, et in fine de « Mont de Lans », où ‘mont’ a ici le
sens de ‘passage, col’–, et redescendait ensuite sur le hameau du Chambon au
bord de la Romanche d’où elle rejoignait la Combe de Malaval (32)
(Fig. 8). On serait donc passé de Lento (ablatif locatif), à Lent,
Lens, Lan, pour finir à Lans (où le ‘s’ final normalement se
prononce ou se prononçait). Le changement de graphie a probablement accompagné
une évolution de la prononciation de [lɛ̃s] à [lɑ̃s].
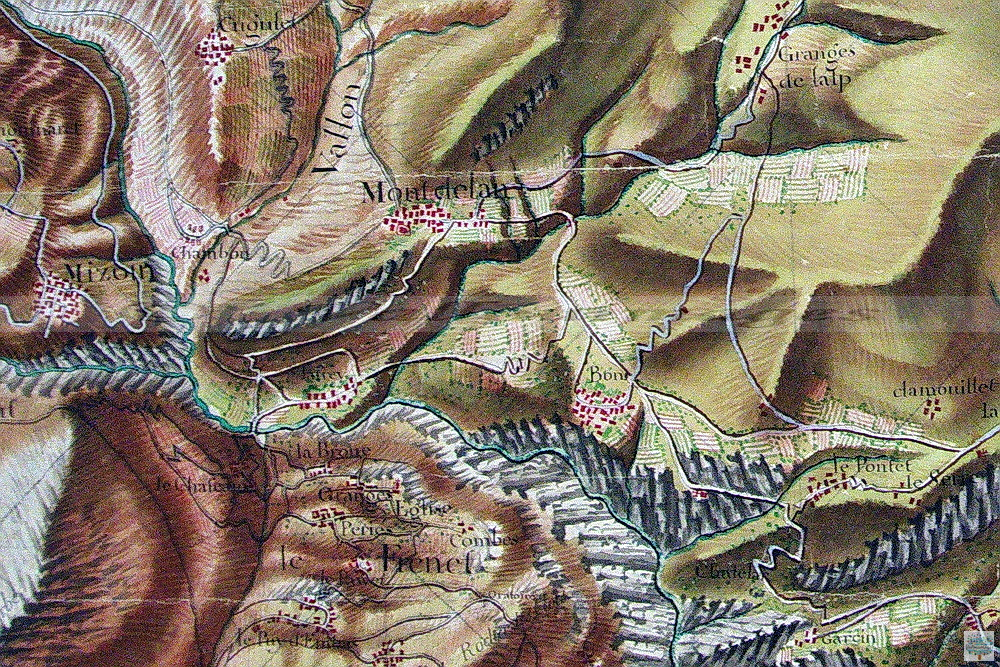
Figure 8 – Extrait des
Minutes de la carte de Bourcet de la Saigne, v. 1750. SHD.
Le village de Mont de Lan(s) et ses environs.
Lento, Lent, Lens,
Lan, Lans
seraient à rattacher à lanche qui correspond en domaine gallo-roman des
Alpes à : « un terrain escarpé en montagne, une bande de terre allongée
(herbeuse ou boisée) orientée dans le sens de la pente, un espace très délimité
resserré en pointe entre ravins » (33). Un nom qui décrit
bien le versant sous la calotte de glace dans la vallée de la Romanche.
Lanche serait à comparer avec fèche, qui dans le patois occitan de La
Grave signifie « une bande étroite qui permet de circuler entre les rochers sur
une pente raide ». Le nom a donné le verbe s’enfècher, « se perdre entre
les rochers en voulant circuler d’un fèche à l’autre, mais en ne trouvant
plus le chemin pour redescendre », autrement dit « s’embarrer ». Les fèches
sont nombreuses sur ce même versant, l’une d’elles s’appelle Fèche Ronde
et correspond à un filon de plomb. C’est également le cas des Enféchores
(‘ch’ prononcé ‘tch’), « des bandes étroites qui permettent de monter en évitant
les rochers » (34).
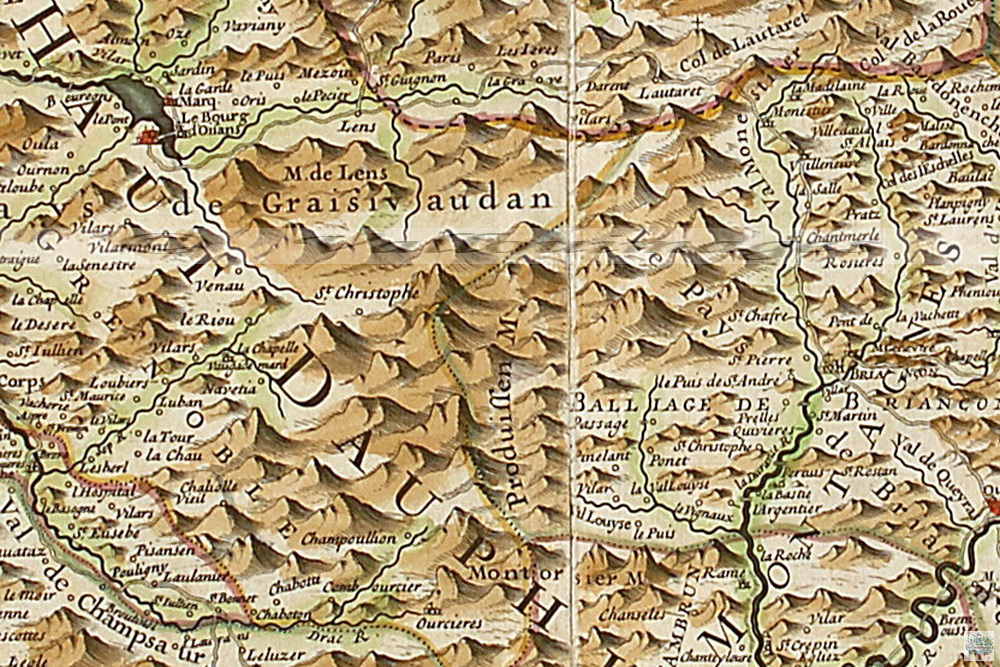
Figure 9 –
Nicolas Sanson, Gouvernement général du Dauphiné, 1692.
Sur une carte de
1692 (Figure 9), Nicolas Sanson distingue le Mont Produissen pour le
massif des Écrins et le Mont de Lens pour le massif de la Meije (35).
D’une part, le Mont de Lens est bien individualisé par sa situation entre
le Mont Produissen et la vallée de la Romanche, – il va grosso modo
(36)
du Jandri au Col du Lautaret –, au point qu’il a été considéré par W.-A.-B.
Coolidge comme l’un des noms de la Meije au cours de son histoire
(37) ;
et d’autre part, il n’y a pas d’ambiguïté avec le village de Lens marqué
au-dessus de la Romanche. D’autres cartes étudiées par Coolidge confirment que
les noms du village et du massif sont devenus deux noms distincts au cours du
XVIIIe siècle.
Les noms de la
paroisse et du village sont donc montés sur les sommets, où ‘mont’ a repris son
sens de ‘montagne’.
La formation des
communes à la révolution a figé « Mont-de-Lans » pour la commune et libéré
« (le) Mont (de) Lens » pour la montagne. Les récits des voyageurs ont en
quelque sorte entériné et popularisé ce nom, d’une part pour le sommet
(au sens le plus large) de la Meije elle-même, d’autre part pour son petit
massif face à La Grave, et enfin pour ses glaciers, « les Glaciers du
Mont de Lens ». On ne pouvait que les désigner comme tels, avant de les
nommer ainsi.
Les descriptions de
William Brockedon parlent d’elles-mêmes. Voici comment il découvre la Meije,
pardon le Mont Lens, avant d’arriver à La Grave en venant de
Villar-d’Arêne en 1824 :
« Tout d’un coup
s’ouvre devant les yeux du voyageur le petit territoire du village de La Grave,
un paysage grandiose. Mont Lens s’élève en face, ses flancs recouverts de
glaciers, et sa base descendant à une très grande profondeur dans la gorge. »
(38).
« Au détour d’une
avancée de rocher […], la neige et les glaciers du Mont Lens se
révélèrent soudain, illuminés par la lune d’un éclat particulier, tandis que la
base de la montagne, s’enfonçait dans le brouillard et l’ombre indéfinie. »
(39).
Puis la descente de
La Grave à Mont-de-Lans :
« Après avoir épousé
l’un des contreforts du Mont Lens, car le trajet depuis La Grave se fait
en réalité à son pied, nous traversâmes le village de Mondelent […]. »
(40).
Les observations
qu’il rapporte et diffuse conduisent à considérer que le Mont Lens est
bien la Meije, sommet, et tous ses contreforts et prolongements « surmontés çà
et là par des glaciers qui semblaient se découper sur le ciel ».
Il rapproche village
et sommet : « Mondelent, village romantique dont le nom dérive évidemment
du Mont Lens. » Eh non ! c’est le village qui est l’éponyme (supra).

Figure 10 – Sabatier – « Sommet du glacier de La Grave » (41)
Il s’agit probablement de notre glacier qui n’avait pas encore son nom.
Autrement dit, il n’y avait rien d’extraordinaire à s’aventurer sur les glaciers
au milieu du XIXe siècle.
Grâce à Brockedon,
encore, la 1re édition du Guide Murray pour la Suisse, la Savoie
et le Piémont (p 335) mentionne « les vastes glaciers du Mont-de-Lens »
qui s’étendent « en face de La Grave »
(42).
Ce nom connut donc
un petit succès parmi les touristes britanniques, mais qui n’alla pas au-delà
des premières indiscrétions concernant les travaux préparatoires à la
réalisation de la carte de l’état-major.
La carte de l’état-major
Car dans le même
temps les ingénieurs géographes de l’état-major effectuaient sur le terrain les
levés de la future carte qui sortira en 1866. Avec l’appui de James Forbes et la
recommandation d’Élie de Beaumont, Francis Fox Tuckett put se rendre au Dépôt de
la Guerre en juillet 1862 où il rencontra les officiers géographes et put
récupérer une copie de la « feuille Briançon » de la carte de l’état-major en
préparation au Dépôt de la Guerre. Il publia une synthèse des informations
recueillies dans un article (43) à la Royal Geographical
Society au mois de décembre 1862. Cette publication mettra fin aux
tâtonnements de ses compatriotes, confondra les approximations et erreurs et
lancera par la même occasion l’assaut sur les Écrins en découvrant sa
face nord.
Les ingénieurs
militaires avaient opté pour le nom vernaculaire des Gravarots et la carte
imposa définitivement « la Meije » pour nommer le sommet et son massif. Le nom
ne fut guère discuté sur le fond, « l’aiguille du Midi ou du Midy (Bourcet) de
La Grave », mais le fut plus sur la forme simplifiée du nom vernaculaire.
Surtout pour le
sujet qui nous occupe, ils avaient réduit le territoire de l’ancien « Mont
(de) Lens », devenu « Mont de Lans » au grand glacier, calotte sommitale de
la montagne du Mont de Lans. Le grand glacier s’appelait enfin « Glacier du Mont
de Lans ».
Un seul nom pour une
immense étendue de glace qui se développait sur les territoires de trois
communes : La Grave, Mont-de-Lans et Saint-Christophe. La Grave en possédait la
plus grande surface alors que Mont-de-Lans n’en possédait qu’une faible étendue
à la marge nord-ouest du dôme glaciaire vers Roche Mantel, parfois dénommée
« Glacier de Mantel ». Mais la partie sommitale à l’ouest du Dôme de la Lauze se
trouvait sur le territoire de Saint-Christophe.
Il y avait là une
discordance entre le cadastre de La Grave, qui date de 1811, et celui de
Saint-Christophe qui lui est postérieur de 18 ans (1829) pour la partie ouest du
glacier. En effet, la partie ouest du Glacier de Mont de Lans du Dôme de la
Lauze au Jandri et à Roche Mantel figurait sur les cadastres des deux communes
(Figures 16 et 17). Se reporter à l’Annexe 2 – Délimitation des communes de La
Grave et de Saint-Christophe-en-Oisans (infra).
Une nouvelle
toponymie
La carte de
l’état-major (feuille de Briançon, n° 189, Figure 11), publiée en 1866 au
1/80 000, mais connue dès 1862 par les informations diffusées par F.F. Tuckett
au sein de l’Alpine Club, renouvela complètement la connaissance de la
topographie des hautes montagnes du Dauphiné, ce qui en facilita grandement
l’exploration. Bien qu’elle ait contribué à l’enrichissement de la toponymie,
les blancs restaient encore nombreux. Particulièrement dans le secteur du
Glacier du Mont de Lans. Néanmoins elle servit de base à toutes les
améliorations successives, et suscita plusieurs vocations de cartographes
toponymistes parmi les touristes devenus alpinistes. Paul Guillemin et Henry
Duhamel, en particulier, s’attelèrent à combler les trous, non sans introduire
d’ailleurs des erreurs par rapport aux noms utilisés localement (44).

Figure 11 – Extrait des
minutes
au 1/40 000 de la carte de l’état-major, centré sur les glaciers
Il fallut attendre
l’année 1875 pour rencontrer la première citation du « Glacier de la Girose ».
Au moins une demi-douzaine d’alpinistes eurent l’occasion de le traverser cette
année-là et l’une de ces traversées fit l’objet d’un compte-rendu : « Le 3 août,
M. Henriot, avec le guide Alexandre Pic, de La Grave, quittait La Grave à trois
heures du matin, traversait malgré un épouvantable orage, les glaciers du
Lac, de la Girose et du Mont-de-Lans, et arrivait à huit heures et demie à
Vénosc. » Tous les autres l’avaient également traversé, mais il fut le seul et
le premier à l’écrire. Le « Glacier de la Girose » venait d’entrer par la petite
porte dans la nomenclature des glaciers des Écrins.
Ce n’était encore
qu’une désignation, mais très vite Paul Guillemin et Henry Duhamel en firent un
toponyme en l’introduisant dans leurs esquisses de cartes. La carte du
Haut-Dauphiné (45) (Figure 12) d’Henry Duhamel publiée en
1887 constitua une nouvelle référence topographique et toponymique du massif des
Écrins que la carte de l’état-major reprendra. Le « Glacier du Mont de Lans »
est divisé en deux sur une ligne reliant la Pointe de Muretouse au Dôme de la
Lauze : à l’ouest le (nouveau) « Glacier de Mont de Lans », à l’est le « Glacier
de la Girose » qui culmine au « Col de la Girose ». Dans le Guide du
Haut-Dauphiné (46) à l’entrée ‘Pointe de Muretouse’, il est
écrit : « Du Col de la Lauze, on atteint ce sommet, point culminant de
l’arête rocheuse soutenant la rive gauche du Glacier de la Girose, en
suivant dans la direction N.-N.-O. l’extrémité orientale du plateau du
Glacier du Mont-de-Lans. (sic) » La séparation est actée, l’un à
l’est, l’autre à l’ouest de cette ligne fictive.
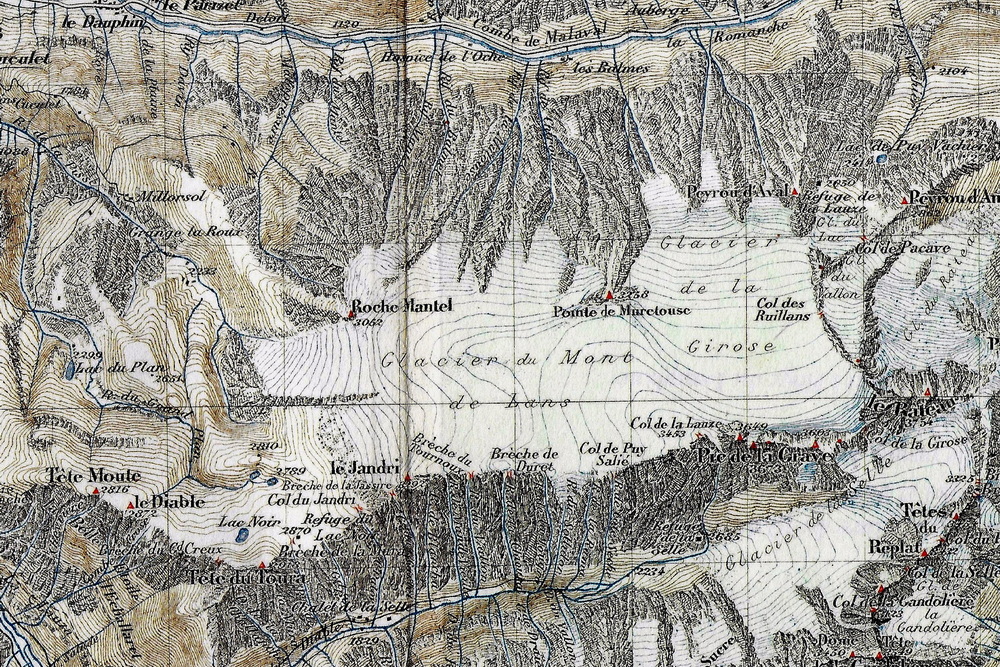
Figure 12 – Extrait de la carte
du Haut-Dauphiné de H. Duhamel, centré sur les glaciers. Bibliothèque
dauphinoise.
Le nom « Glacier du
Mont de Lans » fait toujours référence à un mont « de Lans » fictif. Mais
depuis, on est passé doucement à « Mont-de-Lans », commune, – ce qui représente
un changement d’éponyme –, pour aboutir à « Glacier de Mont-de-Lans » après
suppression de l’article. L’IGN a cru bon de rajouter le nom historique (supra)
« Mantel » qui désignait l’extrémité ouest de la calotte glaciaire disparue
depuis, pour aboutir à « Glacier de Mont-de-Lans ou de Mantel » (Fig. 13).
Le « Col de la
Girose » et le « Glacier de la Girose » eurent leur entrée dans le Dictionnaire
géographique et administratif de la France et de ses colonies (47)
de Paul Joanne :
« On donne le nom de
glacier de la Girose à la grande branche nord-est du vaste glacier du
Mont-de-Lans qui forme la ligne de faîte entre la Romanche au nord et le
ruisseau du Diable ou de la Selle, affl. dr. du Vénéon au sud. Le glacier de
la Girose dont les limites ne sauraient être exactement définies à l’ouest
où il se réunit au glacier du Mont-de-Lans proprement dit est encadré
[…] ». L’ambiguïté demeure entre une branche du Glacier du Mont-de-Lans et un
glacier à part entière.
Le devenir de la
calotte glaciaire
Aujourd’hui la
calotte est en cours de fragmentation et les deux glaciers sont maintenant
séparés à la suite de la disparition de la glace dans une bande aboutissant au
Col de Puy Salié (Figure 13). L’état du Glacier de Mont-de-Lans s’est fortement
dégradé ces dernières années, et son extrémité ouest est en danger, alors que le
Glacier de la Girose résiste mieux grâce à un bassin d’alimentation plus vaste
et orienté au nord. Il n’est plus une branche du ‘grand glacier’ du Mont-de-Lans
devenu moribond. Les deux glaciers vont continuer leur évolution avec des
dynamiques différentes. Le premier est en fort déséquilibre et sa position d’équilibre pourrait bien être sa disparition, le
second fera de la résistance plus longtemps.

Figure 13 – Extrait de la carte IGN au 1/25 000, centré sur les glaciers.
Géoportail, 2025

Figure 14 – État de la calotte glaciaire de Mont-de-Lans. Google Earth.
« De quoi la
Girose est-elle le nom ? ».
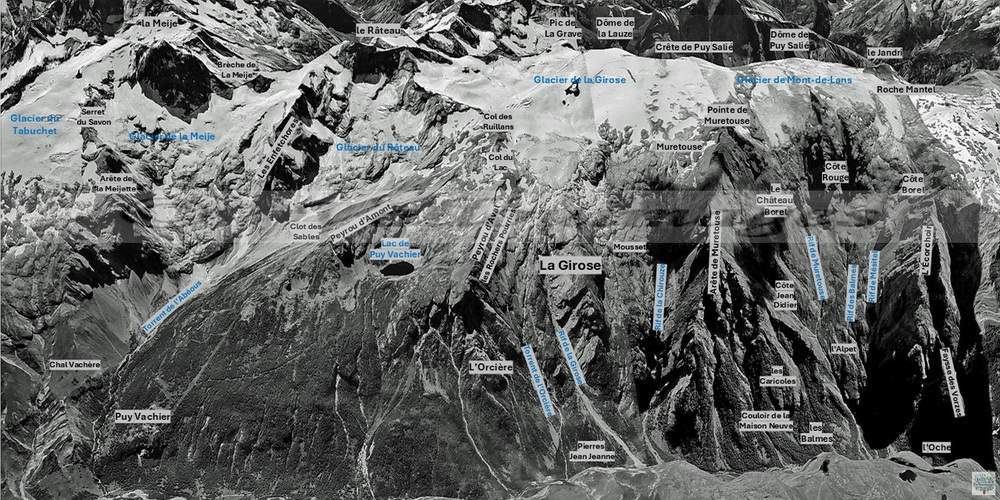
Figure 15 – Panorama toponymique de la Girose. Google Earth.
Eh bien ! de bas en
haut, « la Girose » est devenu le nom de toute la partie centrale du versant
photographié (Figure 15), de la roche du versant à la glace du sommet.
C’était l’histoire
d’un quartier de ‘rocher’ devenu ‘glacier’ mais où la ‘roche’ à nouveau étend
son emprise.
Imagine-t-on la
calotte glaciaire devenir un dôme rocheux, comme un crâne chauve ?
__________
Annexe 1 –
Délimitation des communes de La Grave et de Saint-Christophe-en-Oisans
Il y avait une
discordance entre le cadastre de La Grave, qui date de 1811, et celui de
Saint-Christophe qui lui est postérieur de 18 ans (1829) pour la partie ouest du
glacier. En effet, la partie ouest du Glacier de Mont de Lans du Dôme de la
Lauze au Jandri et à Roche Mantel figurait sur les cadastres des deux communes
(Figures 16 et 17). C’est surprenant car la topographie selon les eaux pendantes
aurait dû conduire à maintenir le rattachement du glacier à La Grave. Mais la
formulation ambiguë du procès-verbal de délimitation de La Grave avec
Saint-Christophe en 1811 est entérinée par le procès-verbal de délimitation de
Saint-Christophe avec La Grave (1827, infra) lors de la réalisation de
son propre cadastre, sans que La Grave s’y oppose. À l’époque, ce bout de
territoire en glace n’avait pas de valeur, il n’en est pas de même aujourd’hui.
Peut-être, Saint-Christophe espérait-il récupérer quelques cristallières ou
mines.
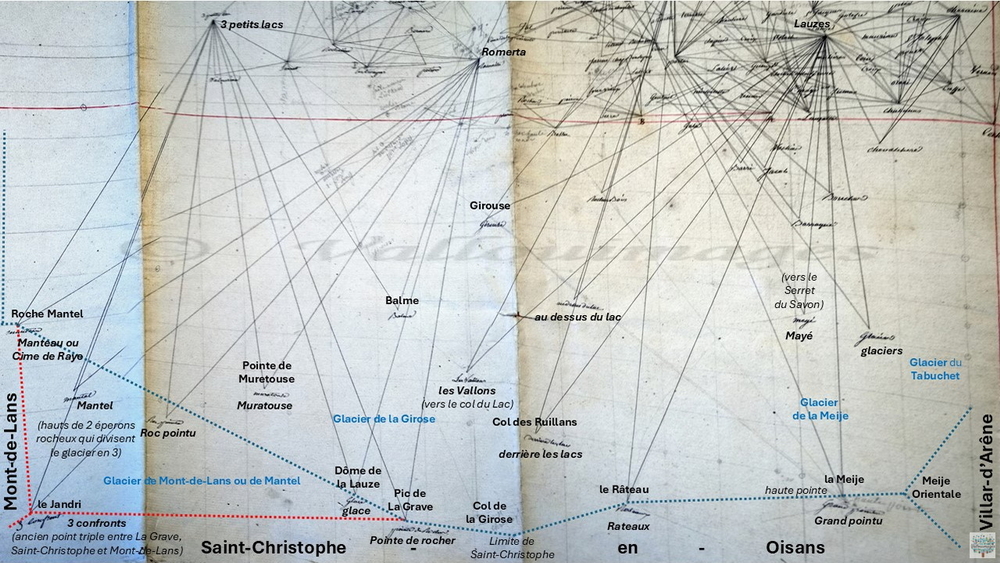
Figure 16 - Canevas de la triangulation
de La Grave (ADHA, 1811).
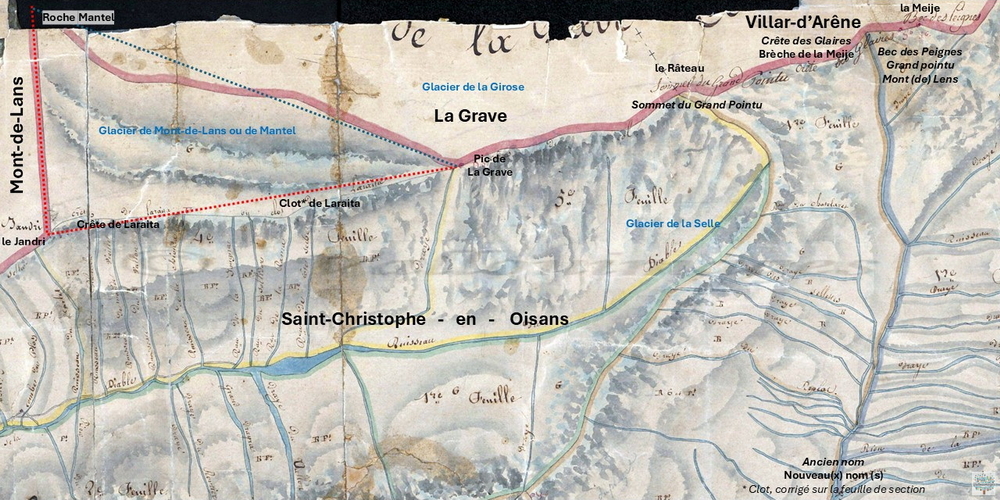
Figure 17 – Tableau d’assemblage de
Saint-Christophe (Archives départementales de l’Isère, 1829).
Les deux figures
présentent la limite des communes de La Grave et de Saint-Christophe (tirets
pointillés) depuis le point triple entre La Grave, Villar-d’Arêne et
Saint-Christophe appelé Grand Pointu jusqu’au point triple (marqué ‘3
confronts’) entre La Grave, Saint-Christophe et Mont-de-Lans, selon les
procès-verbaux de délimitation respectifs entre La Grave et les autres communes.
Le document de
triangulation de La Grave rattache la totalité du « Glacier de Mont-de-Lans ou
de Mantel » à la commune de La Grave (trais en pointillés rouges), contrairement
au cadastre de Saint-Christophe qui se l’approprie (traits en pointillés verts),
ce qui correspond à la situation actuelle. Il faut dire que la formulation du PV
de délimitation de La Grave avec Saint-Christophe en 1811 est très floue en
ouvrant la porte aux deux interprétations :
« la ligne qui
sépare leurs territoires (de La Grave et de Saint-Christophe) se dirige à
l’ouest et suit la crête des glaciers ou rocher jusqu’au plus haut sommet de la
Roche de Mantel ; sommet de rocher qui sert de séparation aux trois communes de
La Grave, Saint Christophe et le Mont de Lans. »
Les noms indiqués
sont nombreux, mais souvent difficiles à relier à des noms existants et en
général pas géolocalisables, d’autant plus que les noms sur les lignes de
délimitation peuvent différer d’une commune à l’autre.
Néanmoins, pour ce
document relatif à la triangulation du cadastre de La Grave, on peut établir les
correspondances suivantes sur la limite sud de La Grave, d’est en ouest :
Grand pointu,
qualifié de ‘haute pointe’, pour « la Meije » (sans autre distinction
entre ses différents pics) ; Rateaux, évidemment pour « le Râteau » ; ‘limite de
Saint-Christophe’, pour « Col de la Girose » ; ‘pointe de rocher’,
pour « Pic de La Grave » ; ‘glace’, pour « Dôme de la Lauze » ; ‘3
confronts’, pour « le Jandri », point triple.
Les géomètres ont eu
sous leurs yeux l’ensemble du versant nord de la Meije et le document qui en
résulte peut tenir lieu de référence à l’époque de sa réalisation.
Les cadastres de
Villar-d’Arêne et de La Grave ont été réalisés en même temps et par les mêmes
géomètres de 1re classe, MM. Kirwan et Durand (48),
respectivement en 1810 et 1811. C’est probablement à cette occasion que le nom
Grand pointu a été introduit à partir de ce qu’ils ont vu lors des
opérations de triangulation. Et vu des hauteurs de La Grave ou de Villar-d’Arêne
d’où les sommets ont été visés (infra), il n’y a qu’un seul Grand
pointu possible, le « Grand Pic de la Meije », c’est-à-dire « la Meije »,
puisqu’à l’époque, on ne distinguait pas tous les sommets secondaires,
occidental, central, oriental. Il n’y avait qu’un seul sommet, au sens de plus
haut point d’une montagne, et avec un seul nom pour l’ensemble. En ce sens, que
le point triple exact se trouve au Pic Oriental ou à un autre ne changeait rien.
D’ailleurs, le nom et le qualificatif de ‘haute cime’ ne pouvaient
convenir qu’au sommet pointu de la Meije. Dans ce contexte, les PV de
délimitation de Villar-d’Arêne et de La Grave concordent entre eux et avec la
topographie.
On notera que ce nom
se rajoute aux désignations anciennes (supra) et au nom local à La Grave,
Meidjo ou « Aiguille du Midi/Midy » pour les ingénieurs géographes
militaires en 1750, mais vu de Villar-d’Arêne le Grand pointu n’indiquait
pas le midi (supra).
|
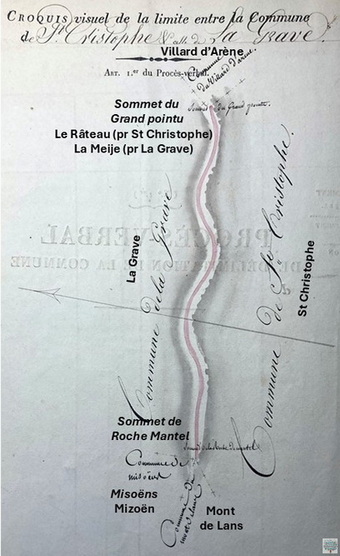 |
Le PV de
délimitation de la commune de Saint-Christophe établi en 1827 en prenant
pour point de départ celui du périmètre de La Grave à la Roche de Mantel,
lève l’ambiguïté :
« Du
Sommet de la roche de Mantel qui forme le point de contact des quatre
communes, du Mont de Lans, Misoëns, La Grave et St Christophe, nous
avons reconnu […] que la ligne séparative des deux territoires était
formé (sic) de l’ouest à l’est par la crête des glaciers
ou rochers jusqu’à un rocher appelé le grand pointu qui fait la limite
entre La Grave et Villard d’Arène. »
(49).
La limite,
toujours actuelle, entre les territoires de Saint-Christophe et de La
Grave va donc de Roche Mantel au Grand Pointu, point triple entre
les communes de Saint-Christophe et de Villar-d’Arêne, d’abord par une
échine glaciaire entre les glaciers du Mont de Lans et de la Girose,
puis par la crête rocheuse, depuis approximativement le Pic de La Grave
et jusqu’au Grand Pointu, clairement identifié à la Meije sur les
cadastres de La Grave et de Villar-d’Arêne, sans distinction à ce stade
entre ses pics, même si on sait aujourd’hui que le point triple est le
Pic Oriental.
Figure 18 – Croquis visuel de la limite entres les communes de
Saint-Christophe et de La Grave.
Procès-verbal de délimitation du territoire de la commune de
Saint-Christophe,
Archives départementales de l’Isère, 1827, cote 1J1023. |
Le
tableau d’assemblage de Saint-Christophe donne également plusieurs noms le long
de la limite nord de Saint-Christophe, avec les correspondances suivantes, d’est
en ouest :
Bec des Peignes,
pour « la Meije » (également sans autre distinction entre ses différents pics) ;
Crête des Glaires, (entre le Râteau et la Meije), pour la « Brèche de la
Meije » ; Sommet du Grand Pointu, pour « le Râteau » ; crête du col
(entre le Râteau et le Col de la Lauze) ; crête de Laraita ou clot
(50)
de Laraita (obscur), (entre le Col de la Lauze et le Jandri) ; Jandri,
pour « le Jandri ».
Les feuilles D1 et
E1 du cadastre de Saint-Christophe montrent sans ambiguïté que le Bec des
Peignes (pt S6) correspond bien à « la Meije », mais indiquent aussi que de
l’autre côté, sur le versant nord, c’est Villar-d’Arêne et non La Grave. Et ce,
jusqu’au Sommet du Grand Pointu, dont la localisation serait alors celle
« du Râteau ». Or, « la Meije ou Bec des Peignes » se situe bien sur la
limite géographique réelle entre les communes de La Grave et de
Saint-Christophe : on est donc obligé de considérer que le Tableau d’assemblage
de Saint-Christophe est erroné. L’erreur peut s’expliquer par les noms multiples
de « la Meije » : « Aiguille du Midi/Midy » pour les Gravarots et la carte de
Bourcet, « Bec des Peignes » pour les Christolets, « Grand Pointu »
pour les cadastres de La Grave et de Villar-d’Arêne. Mais pour les auteurs du
cadastre de Saint-Christophe, la localisation du « Bec des Peignes »
était bien définie : alors où mettre le « Grand Pointu », point triple
indéboulonnable ? Eh bien ! au lieu de considérer qu’un même sommet pouvait
avoir plusieurs noms suivant le point de vue, ils se sont enfoncés dans l’erreur
en le mettant à la place « du Râteau » et en déplaçant le point triple par la
même occasion. Ils n’ont pas vu que les trois noms s’appliquaient à la même
montagne dans des contextes différents.
Le canevas de la
triangulation de La Grave reste bien la référence et la Meije a eu
successivement ou simultanément, différents noms : « Mont (de) Lens, Aiguille du
Midi/Midy, Bec des Peignes, Grand Pointu », et pour finir « la
Meije ».
__________
Annexe 2 – Notes sur
la toponymie ancienne
1
Sur les anciennes cartes, rares étaient les entités nommées précisément hors des
lieux habités. Peu de sommets, cols, accidents de terrain portaient un nom
spécifique. Encore s’agissait-il le plus souvent d’une simple désignation,
souvent descriptive et à couverture plus ou moins large, qui s’est toponymisée
dans la langue alors parlée localement, puis fossilisée et éventuellement
remotivée au fil du temps dans les nouveaux langages. Les anciens toponymes
correspondaient bien souvent à tout un secteur et nommaient tout ce qu’il s’y
trouvait. On les retrouve dans les noms de quartiers des cadastres souvent
repris dans la cartographie issue des cartes de l’état-major de la seconde
moitié du XIXe siècle. Les noms de sommets rapportés sur les cartes ou les
anciens documents, correspondent souvent à des limites, plusieurs sont des
points triples encore en vigueur actuellement. Les procès-verbaux de
délimitation des communes établis lors de l’établissement des cadastres en
fournissent plusieurs, pas toujours repris sur les cartes.
2
Il y avait de
toute façon peu de noms en altitude, dans des secteurs considérés comme non
productifs. Les cadastres sont explicites avec des mentions du type : « limite
où le terrain cesse d’être productif » (cadastre de La Pisse, 05).
3
« La Meije, aiguille du Midi de La Grave », est un exemple de nom correspondant
à un sommet précis (et encore au sens large, allant de la Brèche au Pic Oriental)
et en plus vu d’un secteur limité. A contrario, le nom « Pelvoux » élargi
en « Grand Pelvoux » ne correspondait pas à un sommet précis mais à tout
l’intérieur du massif englobant les principaux sommets entre Vallouise et Vénéon,
tandis que le nom « Écrins » était un nom local connu seulement des gens
fréquentant ses abords en Vallouise, qui s’est étendu à tout le massif au point
de le nommer.
4
À l’origine, aucun nom de lieux ancien n’était déterminé par un article. Ils
sont d’introduction récente, soit à la suite de simples désignations qui,
répétées, se sont progressivement toponymisées, soit par suite de l’effacement
de leur nom générique, selon l’évolution habituelle :
« le col de Granon »
> « le (col de) Granon » > « le Granon » > « le col du Granon », alors que
Granon est un hameau d’estive de la commune de Val-des-Prés, qui s’écrit sans
article !
__________
Notes :
1
Félix de Montety, Université Grenoble Alpes, « De quoi la Girose
est-elle le nom ? », Glacier de la Girose, versant sensible,
Collectif Rimaye, naturographe-editions, novembre 2024, pp. 62-73.
Ouvrage à
lire pour comprendre la problématique et les enjeux du projet.
Je remercie particulièrement Félix pour les échanges que nous avons et
pour les documents échangés.
2
La première traversée connue réalisée par des touristes remonte à 1855.
F. E.
Blackstone, « A sketch of the passage of the Col de la Selle from La
Grave to St. Christophe », Peaks, Passes, and Glaciers, II,
vol. 2, 1862, p. 215-222.
3
Les cadastres napoléoniens les plus anciens, comme ceux de
Villar-d’Arêne (1810) et de La Grave (1811), ne comportent pas les noms
de quartier sur les feuilles de section du plan cadastral parcellaire
(ici 4e feuille de la section K), alors qu’ils figurent sur les
cadastres réalisés plus tard, avec noms et limites. Il faut donc se
reporter à d’autres documents cadastraux, comme le canevas
trigonométrique (Girouse) ou les états de sections (Roche
Giroude en premier jet, ou Roche Girouge après surcharge).
Sachant que le ‘o’ se prononçait [u] (‘ou’), Girouse correspond à
« Girose » tandis que l’informateur pour le parcellaire devait prononcer
[d͡ʒirudzə] (‘djiroudze’), très proche de [d͡ʒirudʒə] (‘djiroudje’).
Voir note 8, infra à propos de la variabilité phonétique.
4
Clot est un nom et un adjectif occitan, signifiant ‘plat, replat’,
particulièrement prolifique en matière toponymique. Une étude en cours,
qui s’appuie sur les états de section des cadastres napoléoniens des
communes du Grand Briançonnais indique qu’il s’agit même du toponyme le
plus fréquent. Malheureusement il donne lieu à de nombreux contresens
avec le français ‘clos’ et même à un non-sens avec le verbe ‘clore’
puisque ‘clôt’ n’en est en français que la 3e personne du
singulier présent et rien d’autre, mais c’est malheureusement suffisant
pour qu’il soit accepté par les correcteurs d’orthographe.
5
La langue vernaculaire dans la haute vallée de la Romanche, et de même
dans la vallée du Vénéon, était un patois rattaché à l’occitan alpin,
proche de celui des vallées briançonnaises de la Guisane et de la
Vallouise.
Nicolas Colomban, « Petite étude géolinguistique de l’Oisans », À la
recherche des patois de l’Oisans, Association coutumes et traditions
de l’Oisans, juin 2021, pp. 23-38.
6
Les références sont multiples :
Dauzat,
Gaston Deslandes, Charles Rostaing, Dictionnaire étymologie des noms
de rivières et de montagnes en France, Éditions Klincksieck, Paris,
1982, pp.125, 150-151.
Jacques
Astor, Dictionnaire des noms de familles et noms de lieux du Midi de
la France, Éditions du Beffroi, 2002, pp. 839-843, 849-851.
Roger
Brunet, Trésor du terroir, Les noms de lieux en France, CNRS
Éditions, Paris, 2016, pp. 228-230.
Paul-Louis
Rousset, Les Alpes et leurs noms de lieux, 1988, pp. 73-99.
8
Cette variabilité phonétique est la combinaison d’une variabilité de
prononciation au niveau des locuteurs et d’une variabilité
d’interprétation au niveau des auditeurs, plus une variabilité au niveau
de la transcription elle-même, l’exemple des suffixes « -rose » et « -rouze »
qui se prononcent de la même façon l’illustre, avec le complément ici
d’une variabilité géolinguistique et peut-être d’une variabilité
diachronique.
9
Nicolas Colomban, « Petite étude géolinguistique de l’Oisans », À la
recherche des patois de l’Oisans, Association coutumes et traditions
de l’Oisans, juin 2021, p. 33-34.
10
Jean-Étienne Guettard, Mémoires sur la minéralogie du Dauphiné, 2
tomes, Paris, impr. de Clousier, 1779.
11
« Auprès du glacier de Girose, il y a une crystallière qui n’est pas
abondante, et au-dessus de la crystallière est un filon de plomb
non exploité. », op. cit., t. 1, pp. 19-20.
12
Op. cit., t. 2, p. 482. « … le glacier de la montagne de Girose
… », « … la cascade de la montagne de Girose … ».
13
« la montagne de la Girose renferme une mine de crystal, et, comme c’est
assez ordinaire à ces mines de crystal, elle est située vers le haut de
cette montagne. On a découvert au-dessus de cette crystallière une mine
de plomb. », op. cit., t. 2, p. 483.
14
Antoine d’Hellancourt, Le voyage de Dhellancourt en Oisans, 1785,
publié par Paul Guillemin, Imprimerie F. Allier père et fils, Grenoble,
1892, pp. 12-13.
15
« Entre le village de La Grave et Loche, sur la rive gauche, se trouve
la mine d’Échilose qui fournit du plomb à la fonderie d’Allmon. Cette
mine est précisément sous un glacier, ce qui en rend l’accès très
difficile à cause des avalanches qui ont lieu fréquemment. »
16
On devine ici la personne qui a écrit le nom tel qu’elle l’a reconstitué
après l’avoir entendu dire ou rapporter. Mais… et vous, devant ce nom
écrit « Échilose », vous pensez [ki-] ou [chi-] ? Localement, [ki-] est
exclu dans les parlers occitans locaux et on balançait entre [[‘d͡ʒi-]
et [t͡ʃi-] (‘dji-’ et ‘tchi-‘) (supra, note 8). Et sachant que dans la
région, les ‘r’ entre voyelles sont roulés (et même battus) et que les
‘o’ se prononcent [u] (‘ou’), vous pensez [chilose] ou [chirouse] ? « Chirouse »,
tiens, tiens…
17
Louis-Étienne Héricart de Thury, « Exploitations immémoriales des
Montagnes d’Huez en Oisans, Département de l’Isère », Journal des
mines, n° 22, second semestre 1807, pp. 281-316, p. 282.
18
Bernard Amouretti, De Briançon au Bourg-d'Oisans, les hommes et la
route au XIXe siècle, Edisud, Aix-en-Provence, 1984.
19
« Rapport sur les mines et usines de l’arrondissement de Briançon, mines
de La Grave », Journal d'agriculture et des arts pour le département
des Hautes-Alpes, Mai 1809, p. 20-21.
« Ces filons
ont été exploités pendant longtemps. Il était très dangereux d’y
travailler à cause des éboulements de neige qui s’y effectuaient tous
les jours. On les a abandonnées […]. »
20
Voir note 8, supra.
21
Montbardon, dans la vallée d’Aoste et Montbardon dans le Queyras sont
même constitués de trois syllabes synonymes !
22
Jules Ronjat, « Restitution de quelques noms de lieux dans l’Oisans »,
Revue des langues romanes, 1908, p. 61.
23
Op. cit., p. 61, note 1. « Roche gelée ou gélive (*gelotica) ».
L’* indique que gelotica est un terme reconstitué, mais dont
l’évolution en girose est plus qu’hypothétique.
24
Annales de la Société d’Études Provençales, 4e année, Aix-en-Provence,
1907, p. 251.
25
On notera qu’à cette époque, on écrivait volontiers le phonème /ʒ/ avec
la lettre ‘j’. Par exemple, la « Tête du Rouget » s’écrivait « Tête du
Roujet ». Peut-être avons-nous échappé à jiroujo ?
26
André Allix, L’Oisans au Moyen Âge, Étude de géographie historique en
haute montagne, Librairie ancienne Honoré Champion, Paris, 1929, pp.
18-28.
27
Les noms de sommets rapportés sur les cartes ou les anciens documents,
correspondent souvent à des limites ou à des bornages, plusieurs sont
des points triples encore en vigueur actuellement. Les procès-verbaux de
délimitation des communes établis lors de l’établissement des cadastres
en fournissent plusieurs, pas toujours repris sur les cartes. Il y avait
de toute façon peu de noms en altitude, dans des secteurs considérés
comme non productifs. Les cadastres sont explicites avec des mentions du
type : « limite où le terrain cesse d’être productif » (cadastre de La
Pisse, 05).
28
Op. cit., p. 26.
29
Op. cit., p. 27.
30
La Blottière, Mémoire concernant les frontières de Piémont et de
Savoye, 1721, rééd. Henry Duhamel, Drevet, Grenoble, p. 136.
31
Pierre-Joseph de Bourcet, Mémoires militaires sur les frontières de
la France […], Chez Levrault Frères, 1801, p. 315.
32
Minutes de la carte de Bourcet de la Saigne, v. 1750.
33
Hubert Bessat, Colette Germi, « lanche », Les noms du paysage alpin,
Ellug, 2001, p.68-73.
34 Gaston Tuaillon, « À la recherche du sens perdu », Le
Monde alpin et rhodanien. n°2-4/1997, « Nommer l’espace », p. 27.
35
Nicolas Sanson, Le gouvernement général du Dauphiné […], Paris,
1692.
36
Grosso modo, car il a fait long feu et n’a pas été réellement
défini. Il ne constitue qu’une étape dans l’invention géographique du
massif, même si aujourd’hui encore, par commodité, on parle toujours du
massif de la Meije pour cette partie du massif des Écrins.
37
W.-A.-B. Coolidge, « La Meije et ses noms divers », Annuaire de la
Société des Touristes du Dauphiné, 27e année, 1901, 2e
série, tome VII, Imprimerie Allier frères, Grenoble, 1902, pp. 180-196.
38
William Brockedon, Passes of the Alps, t. 1, p.26. In W.-A.-B.
Coolidge, « La Meije et ses noms divers », p. 191.
39
William Brockedon, « De Turin à Grenoble par le Col de Montgenèvre »,
Journals of excursion in the Alps, 3e éd., Londres, 1845,
ch. 2. In Michel Tailland, William Bockedon, un peintre à
travers les Alpes, Éditions du Fournel, L’Argentière-la-Bessée,
2005, p. 25.
40
Ibid., p. 27.
41
Baron Taylor, Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne
France, 1854.
42
W.-A.-B. Coolidge, « La Meije et ses noms divers », p. 191.
43
F. F. Tuckett. « The Alps of
Dauphiné »,
Proceedings of the Royal Geographical Society of London, Vol. 7,
No. 1 (1862 – 1863), p. 43-46.
44
Mélaine Le Roy, Jean-Marc Barféty, « "L’invention" des glaciers de
l’Oisans », Glacier de la Girose, versant sensible, Collectif
Rimaye, naturographe-editions, novembre 2024, pp. 30-41.
À lire pour
plus d’informations concernant la découverte de l’Oisans et notamment à
travers la cartographie. Petite remarque amicale, ce sont bien les
ingénieurs/officiers géographes de l’armée qui furent « les pionniers de
l’exploration de l’intérieur du massif » dès le début du XVIIIe
siècle 😉.
45
Henry Duhamel, Carte du Haut-Dauphiné, Grenoble, 1892.
Bibliothèque dauphinoise.
46
Henry Duhamel, Guide du Haut-Dauphiné, Alexandre Gratier
libraire-éditeur, Grenoble, 1887, p. 43.
47
Dictionnaire géographique et administratif de la France et de ses
colonies. III. E-K dir. Paul Joanne, 1890, p. 1703.
48
Il ne peut s'agir du capitaine Durand apparaît qui était
officier du Corps impérial des ingénieurs-géographes rattaché à
l’état-major, après sa formation à l’École polytechnique de 1808 à
1810.
49
La graphie des noms a été respectée.
Procès-verbal de délimitation du territoire de la commune de
Saint-Christophe,
Archives départementales de l’Isère, 1827, cote 1J1023.
50 La feuille A4 du cadastre de Saint-Christophe confirme
la graphie clot et non clos (note 4, supra).
__________
Références :
...
__________
Cet article est susceptible d'être modifié, corrigé, complété au gré
des informations qui me parviennent.